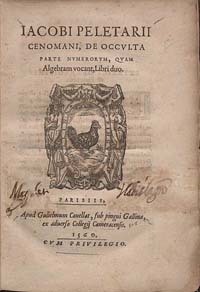Issu d’une famille bourgeoise du Mans [1], il étudia au collège de Navarre [2] avec son frère aîné Jean, mathématicien de renom, fit ensuite des études de droit dans une autre ville. Ces études n’aboutirent pas, mais il se fit tout de même engager comme secrétaire de l’évêque René du Bellay, cousin du père du poète. Il enseigna ensuite la philosophie, et entreprit même des études de médecine, rapidement interrompues. Élève au collège de Coqueret [3], il se lia d’amitié avec Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay.
Nomade comme Clément Janequin, il acheva ses études de médecine entre 1549 et 1552 à Paris, avant de s’installer à Lyon [4] de 1553 à 1557. Dans cette ville, il se lia d’amitié avec les représentants de l’école lyonnaise,Maurice Scève, Louise Labé, mais surtout Pontus de Tyard. Il regagna Paris en 1557, et s’occupa alors uniquement de médecine et de mathématiques, publiant notamment des poèmes scientifiques. Membre du groupe des 7 poètes de la Pléiade en 1555, il publia des poèmes d’inspiration néoplatonicienne “l’Amour des amours” en 1555. Il est l’auteur d’un “Art poétique français” et d’œuvres inspirées par son activité de mathématicien “les Louanges” en 1581.
Il appuya aussi une réforme de l’orthographe, fondée sur la prononciation dans son “Dialogue de l’ortografe e prononciation françoese” conçu sur le modèle du dialogue philosophique, il met en scène un groupe de personnages bien connus des milieux littéraires de ce temps, réunis chez l’imprimeur Michel de Vascosan afin d’y discuter du bien-fondé de la réforme de l’orthographe proposée par Louis Meigret. Tandis que Théodore de Bèze défend l’orthographe traditionnelle, fondée sur une connaissance érudite du latin, Peletier du Mans et Dauron font valoir que la langue savante est déterminée formellement par la langue populaire dont elle procède, les “gens doctes” et les “personnages d’esprit” ne faisant que prendre en charge ce “patron” pour l’enrichir et le perfectionner.
L’un de ses derniers emplois fut celui de professeur de mathématiques à l’Université de Poitiers [5] en 1579.