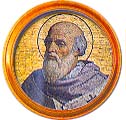Grégoire II (669-731)
89ème Pape de l’Église catholique de 715 à 731
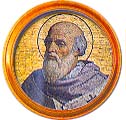
Né à Rome, d’origine romaine, il fit toute sa carrière dans le palais pontifical dont le pape Sergius 1er lui avait confié la bibliothèque. Comme diacre, il accompagna le pape Constantin lors de son voyage à Byzance [1] ou il participa aux discussions du concile de Constantinople en 692 [2] qui marquèrent déjà les dissensions entre l’Église de Rome et Byzance.
Il eut à cette occasion plusieurs conversations avec l’empereur Justinien II sur les divergences entre théologies romaine et byzantine et sur les articles du concile Quinisexte [3], que n’acceptait pas l’Église romaine.
Après la mort du pape Constantin, le 9 avril 715, il fut élu le 19 mai suivant. Dès le début de son pontificat, il fit restaurer les murs de la Ville, puis entreprit des travaux dans les basiliques Saint-Paul-hors-les-Murs [4] et Saint Etienne hors les Murs. Il confia à des moines l’administration de l’hospice des vieillards de l’église Sainte-Marie-Majeure [5].
Son pontificat fut surtout marqué par ses rapports avec les Lombards, les Byzantins et l’Occident. Lorsque l’empereur byzantin Léon l’Isaurien ordonna la destruction de toutes les images, statues, mosaïques, peintures représentant Dieu, le Christ et les saints en 726, il condamna la doctrine iconoclaste [6] et répondit aux menaces de l’empereur par une lettre restée célèbre. Grégoire y opposa la barbarie de l’Orient qui se dit civilisé à la civilisation chrétienne qui se développe dans l’Occident barbare. En 718, il reçut l’Anglo-saxon Wynfrith à qui il imposa le nom de Boniface avec la mission d’évangéliser les païens de la Thuringe [7], de la Hesse [8] et de la Bavière [9], et à qui, en 722, il conféra la consécration épiscopale pour la Germanie [10].
Cultivé et éloquent, il fit promulguer des Constitutions en 721 et fut, selon le Liber pontificalis [11] un “défenseur intrépide des règles de l’Église et opposa une résistance héroïque à toutes les entreprises contraires.” Avec lui la véritable puissance temporelle du pape commence. Il est mort à Rome en 731
Notes
[1] Byzance est une ancienne cité grecque, capitale de la Thrace, située à l’entrée du Bosphore sous une partie de l’actuelle Istanbul. La cité a été reconstruite par Constantin 1er et, renommée Constantinople en 330, elle est devenue la capitale de l’Empire romain, puis de l’Empire romain d’Orient et enfin de l’Empire ottoman à partir de 1453 date de la prise de la ville par les Turcs. Elle fut rebaptisée Istanbul en 1930.
[2] Le concile in Trullo, appelé parfois concile quinisexte ("Cinquième-sixième") ou sixième Concile œcuménique pour ceux qui considèrent les deux conciles (Constantinople III et le concile in Trullo) comme un ensemble, est un concile réuni de 691 à 692 à l’initiative de l’empereur Justinien II.Le concile édicte 102 canons. Les premiers proclament la fidélité aux six premiers conciles œcuméniques et aux canons transmis par la Tradition. Parmi ces derniers, les Pères effectuent un tri : les Constitutions apostoliques (à ne pas confondre avec les canons dits « des apôtres ») sont rejetées ; sont acceptés les canons « des saints hiérarques » (Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Cyrille d’Alexandrie, etc.). Ils abordent ensuite la discipline des clercs, la vie monastique et les laïcs. S’agissant des clercs, ils ordonnent le retour dans leur province de ceux qui en avaient été chassés par les Slaves, les Avars, les Perses ou les Arabes (canon 18). Lorsque c’est physiquement impossible, ils accordent aux évêques dans ce cas de conserver leur rang et leurs prérogatives, ébauchant ainsi ce qui deviendra le titre in partibus infidelium (canon 37). Ils réaffirment Constantinople comme le second patriarcat, derrière Rome mais devant les autres, jouissant des mêmes honneurs que Rome (canon 36).
[3] Le concile in Trullo ou Quinisexte se réunit de 691 à 692 dans la prolongation des IIe et IIIe conciles œcuméniques de Constantinople, réunis en 553 puis en 680–681. Convoqué à l’initiative du seul l’empereur Justinien II, il ne rassemble que des évêques orientaux.
Le concile s’ouvre à l’automne 691 dans une salle à coupole du palais impérial, d’où le nom de in Trullo. Il rassemble 220 évêques, dans leur grande majorité (183) issus du patriarcat de Constantinople. Les patriarches d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem semblent avoir été présents. Le pape, bien que mentionné sur la liste de souscription, n’est pas présent. Basile, évêque de Gortyne, appartenant à l’ancienne Illyrie (de rite latin), se proclame sans légat, sans évidence de preuve. Justinien II réunit ce concile pour mettre fin à la décadence des mœurs qui afflige selon lui l’Empire en réformant le droit canonique. Certaines mesures comme l’autorisation du mariage des prêtres étant contraires aux usages de Rome et de l’Occident, le pape Serge Ier refusa de les entériner. Justinien II ordonna d’appréhender Serge et de le faire comparaître devant le tribunal impérial, comme on avait procédé avec Martin Ier en 653. Les milices de Rome et de Ravenne s’y opposèrent violemment. Justinien fut renversé peu après, ce qui laissa l’humiliation impériale impunie. Mais ce concile accentua les divergences de pratiques séparant les Eglises occidentale et orientale.
[4] L’Abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs est une abbaye bénédictine située à Rome, sur la via Ostiense, à environ deux kilomètres du mur d’Aurélien, l’enceinte fortifiée antique protégeant la ville de Rome. Elle est attenante à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs.
[5] La basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome est l’une des quatre basiliques majeures. Elle est la propriété du Vatican. C’est le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Depuis 1999, l’animation et la pastorale sont confiées aux Frères Franciscains de l’Immaculée.
[6] L’iconoclasme est, au sens strict, la destruction délibérée de symboles ou représentations religieuses appartenant à sa propre culture, généralement pour des motifs religieux ou politiques. Ce courant de pensée rejette l’adoration vouée aux représentations du divin, dans les icônes en particulier. L’iconoclasme est opposé à l’iconodulie. L’iconoclasme ou Querelle des Images est un mouvement hostile au culte des icônes, les images saintes, adorées dans l’Empire romain d’Orient. Il se manifesta aux 8ème et 9ème siècles par des destructions massives d’iconostases et la persécution de leurs adorateurs, les iconophiles ou iconodules. Il caractérise également la Réforme protestante.
[7] Le territoire de cet éphémère royaume s’étendait de l’Elbe et la Mulde à l’est jusqu’à la Hesse incluse à l’ouest, de l’Altmark inclus au nord jusqu’au Danube au sud duquel les Ostrogoths ont étendu leur gouvernement. Tant que cet État a bénéficié de l’alliance scellée avec ces derniers sous le règne de Théodoric, il a perduré comme un État tampon face aux Francs. Inévitablement, leur terre portera leur nom de Thuringe par la suite.
[8] La Hesse est une région historique d’Allemagne, comprise entre le Rhin, le Main et la Weser. Une partie de la Hesse historique forme aujourd’hui le Land de Hesse. La Hesse a aussi donné son nom à une maison souveraine, issue elle-même de celle de Thuringe : la Maison de Hesse. Dès le temps de Charlemagne, on trouve des seigneurs ou comtes de Hesse héréditaires, appelés presque tous Werper ou Gison. Edwige de Gudensberg, héritière de Gison IV porta en 1130 ses domaines dans la maison de Thuringe, mais en 1263, ils en furent détachés, avec le titre de landgraviat de Hesse, en faveur de Henri 1er de Hesse. En 1567, à la mort de Philippe 1er le Magnanime, les landgraves de Hesse se partagèrent en plusieurs branches.
[9] Le duché de Bavière est une ancienne principauté allemande qui fut membre du Saint-Empire romain germanique puis rattaché à l’Électorat de Bavière. Sa capitale était la ville de Munich. Vers l’an 600, le territoire de l’actuel État libre de Bavière était occupé par trois tribus : les Baiern, qui ont donné leur nom au pays (Bavière se dit Bayern en allemand), les Francs et les Suèves. Tandis que l’actuelle Bavière du Nord tombait sous la souveraineté des Francs, les Alamans et les Bavarois formaient, au sud, des territoires souverains séparés par la rivière Lech. À ses débuts, le duché de Bavière s’étendait loin vers l’est et le sud, jusqu’à la Carinthie actuelle, en Basse-Autriche et en Haute-Italie. Mais le cœur du pays se situait sur le Danube. Aux 10ème et 12ème siècles, ces territoires ont donné naissance aux duchés de Bavière, de Carinthie et d’Autriche. Le principal siège ducal était Ratisbonne.
[10] Le Royaume de Germanie n’a pas réellement existé sous ce nom-là. Avec la fin des Carolingiens, les Ottoniens s’imposent et fondent une dynastie qui règne sur la Francie orientale. Pour marquer la différence avec le Royaume de France, on l’appelle Royaume Teutonique. Ce ne sont que les historiens allemands modernes qui lui donnent le nom de Royaume de Germanie. Ce Royaume correspondait au départ aux territoires de la Franconie, de la Saxe et de la Bavière. Mais avec les nombreuses modifications territoriales, le titre de roi de Germanie est devenu honorifique et s’est même pratiquement confondu avec celui de Roi des Romains.
[11] Le Liber Pontificalis (« Livre Pontifical ») est un catalogue chronologique de tous les papes et évêques de Rome, compilé à Rome dans des milieux proches de la curie à partir du 6ème siècle et qui s’arrête au 9ème siècle. C’est une source de l’histoire du haut Moyen Âge ; ses données doivent être reçues avec prudence, surtout pour la période antérieure à sa première rédaction qui reflète surtout l’état des connaissances de ceux qui l’ont écrit.